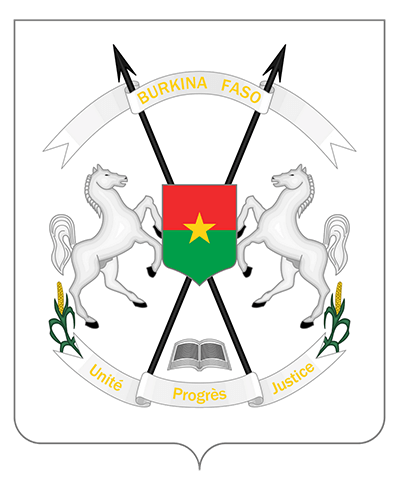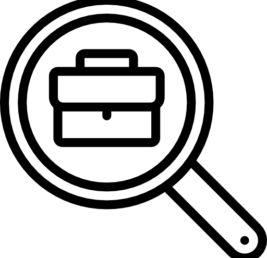Termes de référence – ÉVALUATION EXTERNE DE PROJET
« DROIT ACCES A LA SANTE NORD BURKINA FASO » MEDECINS DU MONDE
Date : Février 2025
- CONTEXTE
- ORIGINE DE LA DEMANDE
Médecins du Monde (MdM) est présente au Burkina Faso depuis plusieurs années, avec pour
mission de promouvoir l’accès aux soins de santé essentiels et la reconnaissance du droit à la santé
pour toutes et tous. Dans un contexte de crise sécuritaire affectant particulièrement le nord du
pays, MdM intervient en soutien aux autorités sanitaires locales pour répondre aux besoins de
santé des populations déplacées et hôtes.
Le projet « Droit Accès à la Santé Nord Burkina Faso » a été conçu pour améliorer l’accès aux
services de santé, en mettant un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive (SSR), la
prise en charge des violences basées sur le genre (VBG), et la santé mentale et le soutien
psychosociale (SMSPS). Il couvre la période 2021-2026 et vise à renforcer les capacités des
structures sanitaires dans le district sanitaire de Kongoussi, au Centre-Nord, une zone fortement
impactée par les conflits et les déplacements massifs de populations.
Le projet, d’un montant total de 15 000 000 $ CAN (dont 14 326 750 $ CAN financé par Affaires
Mondiales Canada (AMC)), a fait l’objet d’un Accord de contribution signé le 12 avril 2021, entre
MdM Canada à titre d’organisation exécutant le projet et AMC.
L’évaluation externe du projet émane de la volonté de Médecins du Monde (MdM) de renforcer la
redevabilité de ses actions et d’améliorer ses stratégies et pratiques opérationnelles ; cette
évaluation fait partie intégrante du projet et a reçu l’autorisation préalable d’AMC.
- BRÈVE PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet « Accès Santé Nord Burkina Faso » est une initiative de MdM déployée dans le district
sanitaire de Kongoussi, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso.
Objectif global : Accroître la jouissance des droits relatifs à la santé, notamment à la santé sexuelle
et reproductive (SSR), pour les femmes, hommes, filles et garçons affecté.e.s par le conflit dans le
nord du Burkina Faso.
Résultats intermédiaires :
- Amélioration de l’utilisation équitable des services de santé primaires (SSP) de qualité, y
compris en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) pour les populations touchées par
le conflit dans le nord du Burkina Faso, en particulier pour les femmes et les adolescentes
- Renforcement des capacités des formations sanitaires (FoSa) pour offrir des services
de santé de qualité, respectueux des droits humains, en particulier pour les femmes et
les adolescentes
- Accès accru aux SSP, y compris de SSR pour les populations les plus éloignées des FoSa
ou affectées par une urgence humanitaire, notamment les femmes et les adolescentes
- Capacités accrues des communautés affectées par les conflits, en particulier des
femmes et des adolescentes, à utiliser les services de SSP, y compris de SSR
- Amélioration de l’environnement social, communautaire et politique en faveur du droit à la
santé, en particulier des droits sexuels et reproductifs (SDSR) et de l’égalité des genres, pour
les femmes et les adolescentes touchées par le conflit au nord du Burkina Faso
- Renforcement des capacités des femmes et adolescentes pour exercer leur droit à la
santé, en particulier en matière de SSR
- Mobilisation des hommes et adolescents pour promouvoir la co-responsabilisation
dans l’accès équitable à la santé
- Mobilisation des acteur.rice.s pour une prise en compte des inégalités de genre en
particulier des enjeux de SDSR dans la réponse d’urgence
Résultats spécifiques et activités clés :
- Services de santé
o Formation des prestataires pour offrir des services de santé primaires (SSP), y compris de
SSR, respectueux des droits à la confidentialité et à la non-discrimination
o Formations sanitaires (FoSa) soutenues pour offrir l’ensemble du paquet de SSP incluant
la SSR (dotations en médicaments, équipements et intrants essentiels ainsi que
réhabilitations non structurelles prenant en compte les mesures de confidentialité et la
sécurité, notamment des femmes et adolescentes)
o Appui technique pour la supervision fournie au district sanitaire pour adapter l’ensemble
des SSP, y compris en cas d’urgence (dont les épidémies)
o Sensibilisation des communautés sur les services disponibles et la prévention des VBG
o Formation et équipement des Agent.e.s de Santé à Base Communautaire (ASBC) et Relais
Communautaires (ReCo) pour la prévention, la prise en charge et la référence en matière
de SSP, y compris de SSR
o Déploiement d’une clinique mobile pour atteindre les populations les plus éloignées des
centres de santé
o Amélioration des systèmes de référence pour les urgences vitales et de gestion des
épidémies
o Appui au district sanitaire pour la gestion des épidémies et la préparation aux réponses
rapides en santé lors d’une urgence humanitaire
- Autonomisation des femmes et adolescentes
o Organisation de sessions de sensibilisation et d’accompagnement pour renforcer leur
pouvoir de décision en matière de santé
o Formation de femmes influentes et de leurs allié.e.s pour promouvoir la protection et les
droits en santé sexuelle et reproductive
o Mise en œuvre d’un programme d’autonomisation au profit des femmes et adolescentes
vulnérables
- Mobilisation des hommes et adolescents
o Formation des hommes et adolescents sur les questions du droit à la santé pour tou.te.s,
incluant la SSR et la lutte contre les VBG, dans les zones ciblées
Termes de référence évaluation Page 3 sur 10
o Engagement de certains hommes et adolescents formés comme pairs-éducateurs pour
promouvoir la co-responsabilisation des hommes et des adolescents sur les questions du
droit à la santé, incluant la SSR y compris les VBG
o Leaders communautaires et religieux renforcés et mobilisés pour la promotion du droit à
la santé pour tou.te.s, incluant la SSR, y compris la lutte contre les VBG
- Plaidoyer et collaboration
o Réalisation d’actions de plaidoyer auprès des autorités pour intégrer les enjeux de genre
dans les politiques de santé
o Partenariats avec les organisations de la société civile (OSC) pour la mise en œuvre et le
suivi des activités
Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Politique d’aide internationale féministe (PAIF)
du Canada, promouvant l’égalité des genres et le droit à la santé pour les femmes et les filles dans
les contextes de crise.
Portée du projet
- Bénéficiaires directs : 288 148 personnes (67 % femmes et filles).
- Bénéficiaires indirects : 303 900 personnes issues des communautés déplacées et hôtes.
- Couverture géographique : 20 FoSa et une clinique mobile desservant 171 villages dans le
district sanitaire de Kongoussi (4 010 Km2
)
Principales parties prenantes du projet et responsabilités
Le projet « Accès Santé Nord Burkina Faso » repose sur une collaboration étroite entre plusieurs
parties prenantes aux rôles complémentaires. L’objectif principal du partenariat est de fournir un
accompagnement organisationnel et technique aux institutions et organisations locales selon leurs
besoins et les ressources disponibles, afin d’atteindre les résultats escomptés.
Les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle stratégique en développant des actions
de plaidoyer aux niveaux local, national, régional et international pour intégrer les questions
d’inégalités de genre et d’accès à la santé dans les politiques publiques. Elles sensibilisent les
communautés sur les thématiques du projet, telles que la SSR et la lutte contre les VBG.
Le réseau des femmes permet aux femmes et adolescentes de mieux s’autonomiser en identifiant
et en accédant aux mécanismes d’auto-support, de protection et de soutien communautaire en
matière de SSR.
Le réseau des pairs éducateurs, composé d’hommes et d’adolescents, renforce la coresponsabilisation sur les questions liées à la SSR et à la lutte contre les VBG. Ce réseau promeut
activement une approche inclusive et égalitaire au sein des communautés.
Le district sanitaire de Kongoussi bénéficie d’un appui pour améliorer la disponibilité et la
motivation des ressources humaines compétentes, renforcer la réponse aux épidémies et
urgences sanitaires, et améliorer la qualité des supervisions dans les FoSa.
Les FoSa de Kongoussi sont soutenues pour accroître la qualité et l’accès aux soins. Cet appui inclut
des interventions visant à garantir la confidentialité, la sécurité, et la non-discrimination, en
particulier pour les femmes et les adolescentes. Les services de santé primaires, y compris en SSR
Termes de référence évaluation Page 4 sur 10
et nutrition, sont également améliorés grâce à des circuits patients optimisés et à une approche
inclusive adaptée aux réalités locales.
Ensemble, ces parties prenantes collaborent pour renforcer le droit à la santé et répondre aux
défis posés par la crise humanitaire et sécuritaire dans le nord du Burkina Faso.
Structure de gouvernance du projet
La gouvernance du projet repose sur une approche participative et inclusive, alignée sur les
principes méthodologiques de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Cette approche offre un
cadre analytique et structurant, orienté vers l’atteinte des objectifs intermédiaires et du résultat
ultime du projet, tout en promouvant le changement durable.
Les processus de gouvernance sont participatifs et mobilisateurs, impliquant l’équipe projet et les
parties prenantes à chaque étape du cycle du projet. Des mécanismes de collaboration continue,
tels que des débats, réflexions et échanges, favorisent la prise de décision collective et le partage
des responsabilités. La transparence dans la communication constitue un principe fondamental,
renforçant la mobilisation des acteur.rice.s autour d’une vision collective orientée vers un impact
à long terme.
L’équipe projet adopte une posture d’accompagnement visant à renforcer l’autonomie et la
responsabilisation des parties prenantes et bénéficiaires. Ce processus, ancré dans une approche
féministe, met l’accent sur la défense des droits et l’autonomisation des femmes et des
adolescentes, tant dans le cadre du projet que dans leur participation aux sphères de la vie
sociétale. Les analyses contextuelles réalisées lors de la conception du projet ont permis
d’identifier les enjeux, risques, acteur.rice.s et besoins prioritaires, particulièrement en matière de
SSR/VBG. Ces analyses servent de base à des stratégies et activités adaptables, ajustées selon
l’évolution du contexte et les retours des bénéficiaires.
Les leçons apprises seront intégrées pour renforcer la qualité des interventions, en favorisant un
apprentissage inclusif qui améliore les pratiques des parties prenantes. Une coordination étroite
avec les autres acteur.rice.s sectoriels et multisectoriels, notamment les autorités sanitaires,
administratives et locales, est mise en œuvre pour assurer une synergie et maximiser l’impact des
actions.
Les structures de gouvernance garantissent une gestion transparente et participative. Ces
instances permettent un suivi rigoureux des plans de travail annuels, des rapports narratifs et
financiers, tout en créant un espace de dialogue critique pour ajuster les interventions et atteindre
les objectifs fixés. Enfin, la qualité du reportage est un élément central de la performance dans la
gestion globale du projet.
- OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION ET PUBLIC VISÉ
- OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
Les objectifs de cette évaluation sont les suivants :
- Vérifier l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la durabilité du projet en tenant compte de
son impact sur les bénéficiaires ;
- Examiner dans quelle mesure les résultats ont été atteints et mesurer l’impact sur l’accès à la
santé des femmes, adolescentes et autres groupes vulnérables ;
- Apprécier les stratégies opérationnelles mises en œuvre, en portant une attention
particulière à l’intégration des dimensions transversales (égalité des genres, environnement,
sensibilité au conflit, durabilité, gouvernance) ;
- Tirer des leçons pour améliorer les futures interventions et informer la prise de décision
quant à la pérennisation des activités ;
- Renforcer la redevabilité auprès des bailleurs et des parties prenantes locales.
- PÉRIMÈTRE DE L’ÉVALUATION
L’évaluation couvrira la période d’activité et portera sur le district sanitaire ciblé.
iii. UTILISATEURS DE L’ÉVALUATION
Les parties prenantes du projet : les ministères en charge de la Santé, de l’action humanitaire et
de la solidarité nationale, et des finances du Burkina Faso, MdM, AMC, ainsi que les
réseaux/coalitions d’organisations non-gouvernementales œuvrant en développement
international au Burkina Faso.
III. ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES
Il est attendu de la personne retenue qu’elle propose une méthodologie participative permettant
de répondre adéquatement aux objectifs de cette évaluation, incluant la formulation des questions
d’évaluation.
En plus de mesurer le rendement du projet en termes qualitatifs et quantitatifs, l’évaluation doit
permettre d’analyser les aspects suivants :
- Pertinence (ex : Dans quelle mesure le projet répond-il aux besoins spécifiques des
populations affectées, notamment les femmes, les adolescentes et les populations déplacées
?)
- Cohérence (ex : Dans quelle mesure l’intervention est-elle adaptée ?)
- Efficacité (ex : Les objectifs ont-ils été atteints de manière équitable pour tous les groupes
sociaux ? Quels ont été les principaux facilitateurs et obstacles ?)
- Efficience (ex : Les ressources allouées ont-elles été utilisées de manière optimale pour
maximiser l’impact ?)
- Impact (ex : Quelles ont été les transformations majeures dans l’accès aux soins de santé des
bénéficiaires ? Existe-t-il des effets non anticipés ?)
- Durabilité (ex : Les actions mises en place peuvent-elles être maintenues après la fin du
financement ? Dans quelle mesure le projet a-t-il renforcé les capacités locales ?)
- La pérennité (entre autres au niveau des autorités et de la communauté)
- L’intégration des questions de genre et d’inclusion sociale à toutes les étapes du cycle de projet
- Le niveau de prise en compte des aspects genre et dans les actions du projet
Les méthodes de collecte de données proposées doivent être de nature qualitative et quantitative.
Le développement de la méthodologie s’appuiera sur les présents termes de référence, sur les
documents clés présentés ci-dessous qui seront partagés avec le/la consultant.e et sur des
entretiens menés avec les personnes listées ci-dessous.
L’évaluation devra inclure une analyse intersectionnelle approfondie afin de comprendre
comment le sexe, l’âge, le handicap, l’ethnicité et le statut de déplacement influencent l’accès aux
soins de santé et la prise en charge des violences basées sur le genre.
L’évaluation devra s’appuyer sur des données désagrégées au-delà du sexe, y compris sur l’âge, le
handicap et le statut socioéconomique des bénéficiaires.
L’évaluation devra strictement respecter les principes éthiques en matière de collecte et d’analyse
des données, notamment en ce qui concerne les violences basées sur le genre (VBG).
Le/la consultant.e devra appliquer les Recommandations d’éthique et de sécurité de l’OMS pour la
recherche sur la VBG, y compris :
- L’obtention du consentement éclairé des participant.e.s, en particulier des survivant.e.s de
VBG ;
- La protection des données et la confidentialité des témoignages ;
- La mise en place de mécanismes de référencement vers des services de soutien pour toute
personne en détresse identifiée au cours de l’évaluation.
- DOCUMENTS CLÉS
Le/La consultant.e devra prendre connaissance d’un certain nombre de documents, dont :
- a) Les documents de projets : plan de mise en œuvre et ses annexes, plans de travail
annuels, cadre de mesure de rendement du projet ;
- b) Les rapports de projet semestriels et annuels remis à AMC ;
- c) Les comptes-rendus des rencontres du Comité pilotage du projet ;
- d) Les différents outils développés par le projet en lien avec l’atteinte des résultats ;
- e) Normes de qualité de l’OCDE pour l’évaluation du développement et autres documents y
référant ;
- f) Recommandations d’éthique et de sécurité de l’OMS pour la recherche sur la VBG.
La liste détaillée de ces documents sera remise à la personne retenue pour conduire l’évaluation
lors de sa réunion préparatoire.
- PERSONNES / INSTITUTIONS CLÉS
- a) Équipes de Médecins du Monde
- b) Équipes cadres du MS (DS)
- c) Responsables des centres de santé soutenus et prestataires de soins
- d) Agent.e.s de santé communautaire, représentant.e.s des OSC
- e) Personnes bénéficiaires directes de l’action (femmes influentes, adolescents et femmes
vulnérables, leaders communautaires et religieux, réseaux de pairs éducateurs…)
La liste détaillée des personnes clés sera remise à la personne retenue pour conduire l’évaluation
lors de sa réunion préparatoire.
- ORGANISATION DE LA MISSION D’ÉVALUATION
- CHRONOGRAMME ENVISAGÉ
L’évaluation devrait avoir lieu entre avril et décembre 2025, avec un niveau d’efforts maximal de
30 jours. La phase de terrain devrait avoir lieu vers octobre et novembre 2025 et inclut des
déplacements dans les zones du projet.
Phase de préparation : Réunion préparatoire, revue documentaire, rédaction des guides et des
outils d’évaluation. Dépôt pour obtention du certificat éthique nationale et autorisation de
collecte de données (5 jours)
Phase de terrain : Collecte et analyse des données, restitution préliminaire (15 jours)
Phase de rédaction du rapport final provisoire (7 jours)
Phase de rédaction du rapport définitif (3 jours)
Le chronogramme provisoire est susceptible d’être modifié à tout moment en fonction de
l’évolution du contexte, notamment de la sécurité et de la possibilité de se rendre sur le terrain.
- PILOTAGE ET REPORTAGE / SUIVI
Le Comité de pilotage de l’évaluation est chargé de recruter le/la consultant.e, d’encadrer
l’évaluation, de commenter et valider les productions délivrées en français et de contribuer
activement à la diffusion des résultats de l’évaluation aux différentes parties prenantes, incluant
les bénéficiaires du projet et les autorités locales.
Le suivi sera assuré par le comité de pilotage (COPIL), qui se réunira selon un calendrier
prévisionnel établi lors de la première réunion.
Une rencontre (en personne et/ou vidéoconférence) sera organisée par le Comité de pilotage avec
le/la consultant.e après réception du rapport de démarrage et du rapport final provisoire.
iii. ORGANISATION LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIVE
Équipement :
– Le/La consultant.e devra fournir le matériel nécessaire à la réalisation de l’évaluation
(ordinateurs, enregistreurs, etc.).
– Il/Elle aura accès à un espace de travail et de rencontres pour les entrevues ou présentations
des résultats aux bureaux de MdM au Burkina Faso.
– Un projecteur sera fourni par MdM pour la présentation des résultats de l’évaluation.
Moyens de communication
– Le/La consultante pourra bénéficier de la connexion internet dans les bureaux de MdM.
– Les coûts de téléphone ou tout frais de communication associée devront être présentés dans
le budget fourni plus bas.
Déplacements / Hébergement
– Un véhicule avec chauffeur sera mis à disposition du/de la consultant.e pour les déplacements
dans le cadre de la mission d’évaluation.
– L’hébergement et les repas ainsi que tout autre frais généré par les déplacements lors de la
mission d’évaluation est à la charge du/de la consultant.e. MdM validera en amont la
localisation de l’hébergement afin de s’assurer qu’elle remplit les conditions de sécurité. Les
déplacements internationaux éventuels, vers/en partance du Burkina Faso restent la
responsabilité du/de la consultant.e en termes de réservation, et les coûts devront être ventilés
dans le budget fourni par le/la consultant.e.
Formalités administratives : L’ensemble des formalités administratives, incluant l’obtention de visa
et d’une assurance santé ou voyage, sont à la charge du/de la consultant.e. MdM pourra produire
tous les documents nécessaires à ces démarches sur demande.
Information confidentielle : Toute information qui sera communiquée dans le cadre de cette
évaluation, concernant soit le personnel, la situation financière ou d’autres affaires de MdM, devra
être traitée en toute confidentialité et ne pourra être révélée à d’autres personnes et/ou
organisations. De plus, tout matériel, témoignage, image, outil, donnée ou document produit ou
Termes de référence évaluation Page 8 sur 10
partagé dans le cadre de cette évaluation devra demeurer confidentiel et ne pourra être partagé
ou diffusé durant la période de l’évaluation de même qu’une fois le l’évaluation terminée.
Propriété : Il est entendu que toutes les données recueillies avec le temps au cours de cette
évaluation, y compris toutes les données informatiques, publications, listes de contacts et autres
informations, sont et demeurent la propriété exclusive de MdM. MdM se réserve tous les droits en
relation avec l’impression, la publication, la distribution ou la vente, en tout ou en partie, sous
quelque forme que ce soit, des rapports et de tout autre produit issu de cette évaluation.
- SÉCURITÉ
Le/La consultant.e devra suivre les règles de sécurité de la mission de MdM au Burkina Faso lors
de la phase terrain. Un briefing sécurité complet sera fait avant le démarrage de la phase terrain.
Toutefois, il est important de noter que MdM ne pourra en aucun cas être tenue responsable de
la sécurité du/de la consultant.e et/ou de son équipe. Le/la consultant.e demeure entièrement
responsable de sa propre sécurité (ainsi que de celle de son équipe, le cas échéant) et devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa protection personnelle.
- Productions et restitutions attendues
- RAPPORT DE DÉMARRAGE
Le rapport de démarrage sera développé par le/la consultant.e et sera soumis au Comité de
pilotage de l’évaluation en amont de la phase terrain pour commentaires et validation. Ce rapport
présentera une proposition de méthodologie détaillée et un plan de travail ainsi que les outils de
collecte prévus pour le recueil des données, un plan d’échantillonnage pour les entretiens et un
calendrier prévisionnel précis de la phase terrain.
- RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ET RECOMMANDATIONS
À la fin de la phase de terrain, le/la consultant.e présentera aux principales parties prenantes du
projet au Burkina Faso les premiers résultats et recommandations qui se dégagent avant l’étape
d’écriture.
iii. RAPPORT FINAL
Un rapport final provisoire sera produit à l’issue de la phase de terrain. Le Comité de pilotage de
l’évaluation disposera de deux semaines à partir de sa réception pour émettre des commentaires
et avis.
Le rapport final définitif devra intégrer les commentaires / remarques / discussions / échanges /
recommandations produits par le comité de pilotage après lecture du rapport final provisoire.
Le texte principal du rapport d’évaluation, en format Word, doit comprendre entre 30 et 50 pages
(sans compter les annexes), caractère 11 et simple interligne, et doit inclure les parties suivantes :
- a) Résumé exécutif (5 pages maximum)
- b) Introduction
- c) Liste des acronymes
- d) Contexte (description du projet)
- e) Objectifs de l’évaluation
- f) Méthodologie et limites
- g) Principaux résultats
- h) Analyse et leçons apprises (positives et négatives)
- i) Contraintes ayant un impact sur le projet
- j) Conclusions et recommandations, incluant une proposition synthétique des actions à garder
pour les interventions futures,
- k) Annexes : termes de référence de l’évaluation, liste des personnes rencontrées, calendrier
des activités de collecte de données, guides d’entretiens, bibliographie, etc.
- Budget
Le budget global de l’évaluation ne pourra pas dépasser 25 000 $ CAD. La consultante ou le
consultant doit soumettre un budget détaillé suivant le modèle suivant :
VII. Compétences requises pour mener la mission
Il est requis du/de la consultante :
- Une maîtrise et une expérience démontrée d’au moins 4 ans en matière d’évaluation de
projets de santé et de leurs méthodologies ;
- Une bonne expérience en matière de coopération et de développement international ;
- Une expérience professionnelle au Burkina Faso, un atout ;
- Une bonne connaissance des systèmes de santé au Burkina Faso ;
- Une bonne connaissance du contexte de la région Centre-Nord ;
- Une solide expérience dans l’animation de processus participatif (entretiens, focus group
multi-acteurs) ;
- Une expertise démontrée en genre, expertise en évaluation féministe et analyse
intersectionnelle un atout ;
- De bonnes capacités organisationnelles, y compris la capacité à fournir les livrables dans les
délais impartis ;
Termes de référence évaluation Page 10 sur 10
- Un bon jugement, leadership, autonomie ;
- Une excellente capacité d’écriture et faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse ;
- Une maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, une maîtrise du mooré parlé et écrit est un atout
important.
Les candidatures d’équipes dirigées par des femmes ou de consultantes ayant une expertise
avérée en genre et inclusion sociale sont particulièrement encouragées.
VIII. Dossier de candidature
Les personnes intéressées doivent transmettre une proposition technique détaillée contenant
les éléments suivants :
- La compréhension des termes de référence ;
- L’approche technique développée et la méthodologie ;
- Leur Curriculum Vitae et leur disponibilité (s’il s’agit d’une équipe : sa constitution, la
répartition des responsabilités entre ses membres) ;
- Le calendrier prévisionnel de la mission d’évaluation (incluant la stratégie d’accès à la région
Centre-Nord ainsi que les stratégies au niveau linguistique (via consultant local ou autre) ;
- Une proposition budgétaire incluant toutes les taxes et comprenant une ventilation du
budget (honoraires, frais de subsistance, déplacement, interprète, etc.)
- Les références de 2 travaux similaires antérieurs ;
- Une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de conflit d’intérêt.